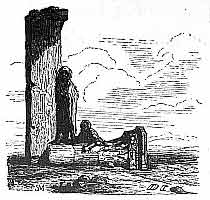 E
19 septembre 1839, à dix heures du matin, la petite ville
de Port-Vendres, élégamment pavoisée, recevait
LL. AA. RR. Le duc et la duchesse d’Orléans. Sa
popularité, grossie de toute celle des villages voisins,
remplissait les rues et le port. Deux navires à vapeur
étaient en rade, le Phare, commandé par M. de
Gasquet, lieutenant de vaisseau, et le Crocodile, commandé
par M. Simon, officier du même grade, sous le commandement
supérieur de M. Delassaux, capitaine. E
19 septembre 1839, à dix heures du matin, la petite ville
de Port-Vendres, élégamment pavoisée, recevait
LL. AA. RR. Le duc et la duchesse d’Orléans. Sa
popularité, grossie de toute celle des villages voisins,
remplissait les rues et le port. Deux navires à vapeur
étaient en rade, le Phare, commandé par M. de
Gasquet, lieutenant de vaisseau, et le Crocodile, commandé
par M. Simon, officier du même grade, sous le commandement
supérieur de M. Delassaux, capitaine.
A midi, le prince royal était monté à
bord du Phare.
A une heure l’ancre dérapée quittait le
fond, et l’équipage s’éloignait des
côtes de France sans les perdre de regard.
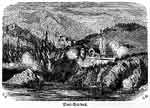 Un
instant après le rivage offrait aux voyageurs un spectacle
pittoresque et solennel. Le peuple couvrait les hauteurs ou
ruisselait sur les chemins, ou venait inonder la grève.
Derrière les collines qui embrassent la ville, les montagnes
les plus voisines paraissaient comme étagées en
échelons ou en gradins, et plus loin l’horizon
était fermé par la haute chaîne des Pyrénées,
que surmontait la pointe abrupte du Canigou. Un
instant après le rivage offrait aux voyageurs un spectacle
pittoresque et solennel. Le peuple couvrait les hauteurs ou
ruisselait sur les chemins, ou venait inonder la grève.
Derrière les collines qui embrassent la ville, les montagnes
les plus voisines paraissaient comme étagées en
échelons ou en gradins, et plus loin l’horizon
était fermé par la haute chaîne des Pyrénées,
que surmontait la pointe abrupte du Canigou.
Le temps était superbe. Le Phare cinglait au milieu d’une
multitude de bateaux français et catalans, aux voiles
latines, qui le saluaient en passant. Le vent semble se montrer
contraire, et la mer devient houleuse au moment an l’on
double le cap Creuss, mais l’air n’a pas cessé
d’être pur et transparent et au bout de quelques
heures le bâtiment a laissé derrière lui
les côtes d’Espagne dont l’azur se confond
peu à peu avec celui du ciel.
Le vendredi 20, à huit heures du matin, le vent est
debout la mer est un peu agitée, mais le Phare
file ses six nœuds. Le Crocodile le suit à
la portée du canon.
 Vers
midi, au sud-sud-ouest se découvre el Toro, la plus haute
montagne de l’île de Minorque, semblable à
une pyramide renversée sur le côté. C’est
là que s’appuierait la pile colossale d’un
pont de Titans jeté entre l’Europe et l’Afrique. Vers
midi, au sud-sud-ouest se découvre el Toro, la plus haute
montagne de l’île de Minorque, semblable à
une pyramide renversée sur le côté. C’est
là que s’appuierait la pile colossale d’un
pont de Titans jeté entre l’Europe et l’Afrique.
A six heures, au déclin du jour, le Phare double la
Mola et entre dans la passe pendant que le soleil achève
de s’abaisser à l’occident, et que la lune
commence à s’élever du côté
opposé, tableau sublime dont le vaste espace de la mer
agrandit le cadre. On a essayé quelquefois de le peindre
ou de le décrire, mais c’est dans le ciel qu’il
faut le voir, car il n’y a ni plume ni pinceau qui puisse
en retracer la magnificence.
A gauche disparaissent rapidement le fort Saint-Philippe et
le village de San-Carlos, à droite le lazaret. Au fond
de sa belle rade, Mahon se déploie en amphithéâtre,
avec ses maisons peintes de jaune et de blanc, et, à
mesure que la nuit rend les objets moins visibles, les lumières
de la ville brillent avec plus d’éclat.
Le Phare vient mouiller près du stationnaire français
la Lamproie. Soumis à la réserve, discrète
de l’incognito, le Crocodile tient la mer.
 Le
samedi 21, à six heures du matin, le prince descend à
Mahon avec quelques officiers, sans y être annoncé.
On gravit les rues escarpées quiconduisent à la
ville haute, et on visite l’église des Carmes et
le cathédrale de Santa-Maria, édifice du XVIIe
siècle, et par conséquent de peu d’importance
pour l’art, où l’on remarque cependant un
bel autel à colonnes torses, dorées et sculptées,
avec des figures enroulées d’un effet assez piquant.
L’auditoire a quelque chose de plus neuf et de plus curieux
pou le voyageur qui n’a jamais pénétré
auparavant dans une basilique espagnole. Ce sont, sur les bas
côtés, des centaines de femmes immobiles, dans
leur costume lugubre et monotone, agenouillées comme
des statues de marbre noir, et que l’on croirait pétrifiées
en effet, si la vie, qui manque à toute leur apparence
extérieure, ne s’était réfugiée
dans leurs regards ; puis, çà et là, des
groupes épars et pittoresques de soldats, de paysans
baléares, de mendiants fièrement drapés
dans leurs haillons, et qui semblent attendre le pinceau d’un
grand artiste. Au maître-autel, c’est le prêtre,
officiant sous sa chasuble en forme de violoncelle, et murmurant
les prières de la messe d’une voix basse qui ne
trouble pas le silence universel, à peine animé
par le perpétuel mouvement des éventails ou abanicos. Le
samedi 21, à six heures du matin, le prince descend à
Mahon avec quelques officiers, sans y être annoncé.
On gravit les rues escarpées quiconduisent à la
ville haute, et on visite l’église des Carmes et
le cathédrale de Santa-Maria, édifice du XVIIe
siècle, et par conséquent de peu d’importance
pour l’art, où l’on remarque cependant un
bel autel à colonnes torses, dorées et sculptées,
avec des figures enroulées d’un effet assez piquant.
L’auditoire a quelque chose de plus neuf et de plus curieux
pou le voyageur qui n’a jamais pénétré
auparavant dans une basilique espagnole. Ce sont, sur les bas
côtés, des centaines de femmes immobiles, dans
leur costume lugubre et monotone, agenouillées comme
des statues de marbre noir, et que l’on croirait pétrifiées
en effet, si la vie, qui manque à toute leur apparence
extérieure, ne s’était réfugiée
dans leurs regards ; puis, çà et là, des
groupes épars et pittoresques de soldats, de paysans
baléares, de mendiants fièrement drapés
dans leurs haillons, et qui semblent attendre le pinceau d’un
grand artiste. Au maître-autel, c’est le prêtre,
officiant sous sa chasuble en forme de violoncelle, et murmurant
les prières de la messe d’une voix basse qui ne
trouble pas le silence universel, à peine animé
par le perpétuel mouvement des éventails ou abanicos.
A huit heures cette petite station était finie ; le
Phare sortait des passes et rejoignait le Crocodile.
Le ciel était pur, le vent debout, la mer grosse et houleuse.
Le dimanche 22 le temps n’a pas cessé d’être
magnifique. On a vu avec émotion l’île de
Cabrera, si douloureusement mémorable par les souffrances
inouïes des prisonniers français. On reconnaît
à une heure le cap Tenez. Les bonites qui bondissent
le long du bord annoncent le voisinage de mers chaudes. Le bâtiment
longe la côte à dix lieues au large.
 Lundi
le vent toujours debout, semble tourner avec le vaisseau ; il
passe à midi au calme plat. Le Phare distingue bientôt
l’embouchure du Chélif, la rivière sacrée
des Arabes. On nomme tour à tour Mostaganem, Arzew, le
cap Fera, la montagne des Lions, si remarquable par sa belle
couleur fauve, ses rochers, ses cavernes, et dont les contours
se dessinent si nettement sur le tond bleu de l’horizon.
Le bâtiment gouverne sur Mers-el-Kebir. Lundi
le vent toujours debout, semble tourner avec le vaisseau ; il
passe à midi au calme plat. Le Phare distingue bientôt
l’embouchure du Chélif, la rivière sacrée
des Arabes. On nomme tour à tour Mostaganem, Arzew, le
cap Fera, la montagne des Lions, si remarquable par sa belle
couleur fauve, ses rochers, ses cavernes, et dont les contours
se dessinent si nettement sur le tond bleu de l’horizon.
Le bâtiment gouverne sur Mers-el-Kebir.
 A
quatre heures on aperçoit Oran. Située sur les
deux crêtes d’un ravin qui court du sud au nord,
cette ville présente un aspect pittoresque et singulier.
L’œil saisit d’abord dans son ensemble la Casbah
ou Casauba, qui se distingue de tous les autres bâtiments
par son imposante dimension, ses deux grosses tours rondes et
blanches, et sa ceinture crénelée, hérissée
de canons ; elle s’élève à la partie
orientale du ravin. Du même côté on remarque
encore le fort Saint-André, construction gigantesque
des Espagnols, qui n’est peut-être pas irréprochable
aux yeux d’un ingénieur habile, mais qui ne laisse
rien à désirer, comme fabrique, à l’imagination
et au goût de l’artiste. Il en est de même
des trois forts échelonnés qui se superposent
à l’ouest : le fort de Santa-Cruz, au sommet de
la montagne ; le fort San-Gregorio, qui s’assied au milieu
du revers, et le fort inférieur, qui vient baigner dans
la mer le pied des murailles ; ce dernier commande la route
nouvelle qui conduit d’Oran à Mers-el-Kebir. La
crête rougeâtre de la montagne relie entre elles
ces trois forteresses. L’intérieur du ravin est
rempli de peupliers de Hollande, de figuiers, de cactus énormes,
et la fraîcheur de cette belle végétation
est entretenue par un courant d’eau vive qui descend jusqu’à
son embouchure, en arrosant çà et là de
nombreux jardins étendus sur l’un et l’autre
flanc de ces collines jumelles, comme une tapisserie de verdure. A
quatre heures on aperçoit Oran. Située sur les
deux crêtes d’un ravin qui court du sud au nord,
cette ville présente un aspect pittoresque et singulier.
L’œil saisit d’abord dans son ensemble la Casbah
ou Casauba, qui se distingue de tous les autres bâtiments
par son imposante dimension, ses deux grosses tours rondes et
blanches, et sa ceinture crénelée, hérissée
de canons ; elle s’élève à la partie
orientale du ravin. Du même côté on remarque
encore le fort Saint-André, construction gigantesque
des Espagnols, qui n’est peut-être pas irréprochable
aux yeux d’un ingénieur habile, mais qui ne laisse
rien à désirer, comme fabrique, à l’imagination
et au goût de l’artiste. Il en est de même
des trois forts échelonnés qui se superposent
à l’ouest : le fort de Santa-Cruz, au sommet de
la montagne ; le fort San-Gregorio, qui s’assied au milieu
du revers, et le fort inférieur, qui vient baigner dans
la mer le pied des murailles ; ce dernier commande la route
nouvelle qui conduit d’Oran à Mers-el-Kebir. La
crête rougeâtre de la montagne relie entre elles
ces trois forteresses. L’intérieur du ravin est
rempli de peupliers de Hollande, de figuiers, de cactus énormes,
et la fraîcheur de cette belle végétation
est entretenue par un courant d’eau vive qui descend jusqu’à
son embouchure, en arrosant çà et là de
nombreux jardins étendus sur l’un et l’autre
flanc de ces collines jumelles, comme une tapisserie de verdure.
Peu à peu le point de vue se rapproche, les détails
deviennent plus nets, les maisons se détachent les unes
des autres, éclatantes de blancheur, comme dans presque
tout l’Orient, et si resplendissantes au soleil, qu’elles
font comprendre le prestige de ces compagnons de Cortez qui
prirent les premières villes mexicaines pour des villes
d’argent. Le maréchal gouverneur avait été
retenu à Alger. Le général Guéheneuc
était malade. Le prince royal fut reçu au débarcadère
par les colonels de Montpezat, de Maussion et Devaux.
 |